ARGIOLAS Ange [ARGIOLAS Angelo, dit Ange]
- Renaud Poulain-Argiolas
- 1 déc. 2023
- 10 min de lecture
Dernière mise à jour : 13 févr.
Né le 2 décembre 1893 à Oniferi (province de Nuoro) en Sardaigne (Italie), mort le 29 octobre 1985 à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) ; manœuvre et docker ; antifasciste italien ; militant communiste de Port-de-Bouc.

Les parents d’Angelo Argiolas, Paolino Argiolas et Pasqua Sanna étaient des paysans, nés eux-mêmes au village d’Oniferi, en Barbagia, région de Sardaigne réputée pour sa sauvagerie. Le patronyme Argiolas viendrait du sarde "argiola", qui désigne l’aire pour battre le blé. Angelo était le sixième d’une fratrie de neuf enfants et le dernier garçon. Indice probable de la dureté des conditions de vie, seulement six des enfants arrivèrent à l’âge adulte (trois garçons et trois filles) : Paola (née en 1881), Salvatore (1886), Antioco (1889), Giovanna Maria (1899) et Caterina (1901).
Comme la plupart des jeunes hommes de sa condition dans son village, il travailla un temps comme berger. Ses idées tranchaient-elles déjà avec celles de sa famille très attachée à l’église catholique, comme le suggérait un commentaire d’une de ses nièces plus de quarante ans après sa disparition : "C’était un homme bien, mais il était athée..." ? Mobilisé dans la Première guerre mondiale à partir de juillet 1915, il combattit dans l’armée italienne avec ses frères aînés Antioco et Salvatore. Il fut envoyé en Serbie, blessé en 1916 et prisonnier de guerre du 26 octobre 1917 au 12 novembre 1918. On le décora de la médaille de l’Ordre de Vittorio Veneto.

Angelo Argiolas quitta la Sardaigne en 1920, avec, comme beaucoup d’immigrés du Sud de l’Europe, le projet de trouver du travail en France. D’après la demande de naturalisation qu’il fera plus tard, il s’installa en France le 22 mars 1920 sans y avoir fait de séjour préalable. Il se fit embaucher à L’Estaque, où l’activité industrielle attirait de nombreux immigrés. Les travailleurs étrangers formaient des communautés selon leur culture d’origine : corse, algérienne ou italienne – et parmi les Italiens un certain nombre de Sardes. Il fut employé dans une tuilerie. À l’Estaque-Plage, une famille sarde, les Cesaraccio, tenait une cantine ouvrière et une sorte de pension au n°2 place de l’Église. C’est vraisemblablement en découvrant l’établissement qu’il rencontra Battistina Cesaraccio, fille de la patronne qui y faisait le service. Paulino et Pietro Cesaraccio virent d’un mauvais œil Angelo fréquenter leur sœur. Ils l’agressèrent pour le tenir à distance. Cela n’empêcha pas Angelo de loger à cette adresse jusqu’en 1922. Le 28 janvier de la même année, il épousait Battistina à la chancellerie du Consulat d’Italie à Marseille. Les Français francisèrent leurs prénoms en Ange et Baptistine. Ils vécurent ensuite à L’Estaque-Riaux – à la Maison Ranti et aux Établissements Kuhlmann – jusqu’en 1925. Deux fils naquirent de leur union : Paul en 1922 et Jean-Marie en 1924.

Est-ce que c’était pour laisser derrière eux les problèmes qui avaient touché la famille Cesaraccio à partir de 1923 que le couple quitta L’Estaque ? La mère de Battistina, Maria Cesaraccio, avait été condamnée à deux ans de prison pour recel de marchandises volées dans des trains près de la gare voisine. L’affaire avait fait du bruit dans la presse locale, depuis l’échange de coups de feu entre des cambrioleurs masqués et les agents de la police ferroviaire jusqu’à l’inculpation de Maria et de son fils Pietro Cesaraccio, qui avait pris la fuite et été condamné par contumace. Une des sœurs de Baptistine et son mari avaient également été impliqués avant d’être relâchés. La majeure partie des Cesaraccio s’installa dans le Doubs au printemps 1925. Ange et Baptistine Argiolas les rejoignirent. Ils habitèrent la Maison Cartozi à Dasle du 2 au 20 juillet 1925. De mémoire familiale, la population protestante aurait mal accueillis ces Italiens supposément catholiques, les incitant à déménager. Ils logèrent à Valentigney au n°85 cités Sous-roches à l’adresse de Maria Cesaraccio. Ange fut employé dans la commune chez Peugeot frères en tant que manœuvre du 2 juillet 1925 au 25 mars 1926.

Le 26 mars 1926 les Argiolas revenaient en Provence. Ils s’installèrent près de l’étang de Berre, bassin industriel en expansion, dans le quartier de la Tranchée de Port-de-Bouc. Ils retrouvèrent la solidarité soudant la communauté sarde qu’ils avaient connue à L’Estaque. Dans le quartier, il y avait une de ces cantines tenue par un couple de compatriotes, François et Madeleine Santoru, de ces lieux qui contribuaient à fédérer et à intégrer les travailleurs immigrés. Les hommes s’y regroupaient après leur travail. Ils y partageaient une ambiance d’entraide chaleureuse face à la dureté de leurs conditions de vie. Antoine Santoru, un des fils des patrons de la cantine, raconta sous la plume de Roland Joly que les Sardes se réunissaient parfois à l’écart dans l’arrière salle, une bonbonne de vin sur la table pour organiser des stornelli, séances de poésie traditionnelle improvisée. Ils restaient jusqu’à tard dans la soirée à se houspiller et à se raconter leurs vies.
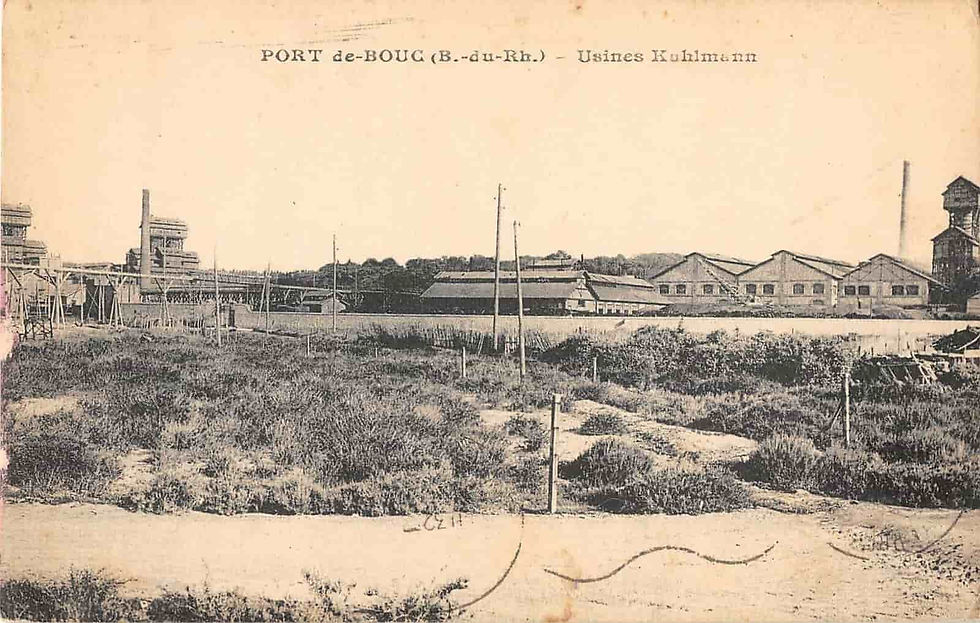
À Port-de-Bouc, le couple Argiolas eut deux filles : Pascaline (1926) et Élisabeth (1930). En 1931, ils vivaient toujours à la Tranchée. Ils avaient pour voisins les Santoru qui avaient quatre enfants (Pierre, Marie, Séverine et Antoine) ainsi que les Brocca qui en avaient trois (Sauveur, Pierre et Catherine). Ange était journalier à l’usine Kuhlmann située dans la commune. Quelque temps plus tard, la famille déménagea dans le quartier des Comtes. Les filles Argiolas reçurent une éducation traditionnelle très stricte, leur père n’hésitant pas à intervenir dans leurs relations de couple naissantes. À la maison, les parents pouvaient parler sarde, y compris avec leurs enfants. Le chef de famille déclarera à l’administration française avoir officié chez Kuhlmann comme manœuvre à partir de 1932. Il est difficile de dater avec précision le moment où les Argiolas adhérèrent aux idées communistes. On sait qu’elles furent partagées par les parents et leurs enfants. Un ami des Argiolas d’Oniferi témoigna qu’Ange écrivait des lettres à sa mère et à sa sœur Giovanna Maria dans lesquelles il critiquait ouvertement le régime fasciste. Passées entre les mains de la censure italienne, celles-ci auraient pu attirer des problèmes à leurs destinataires. Dans sa jeunesse, il leur adressait également des poèmes qu’il composait.
Les enfants Argiolas devinrent français par déclaration devant le juge de Paix de Martigues le 20 février 1936, enregistrée au ministère de la Justice le 8 mars 1937. Les parents sollicitèrent leur propre naturalisation le 10 novembre 1937 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône. Du fait de leurs revenus modestes, ils demandèrent une réduction des droits de sceau et offrirent la somme de 150 F, soit un tiers de la somme totale. La demande fut enregistrée le 8 avril 1938 par le ministère de la Justice. On y mentionnait qu’ils étaient assimilés et avaient adopté les usages français, qu’ils parlaient correctement la langue, savaient lire et écrire, fréquentaient essentiellement des Français et que leurs enfants allaient à l’école en France. Les patrons d’Ange le disaient bon ouvrier. Il gagnait 47 F par jour avec son emploi de manœuvre chez Kuhlmann, payait 90 F de loyer mensuel et 73 F de contributions. Il écrivait ne pas s’occuper de politique. Le dossier fut tamponné une première fois le 16 mai 1938 et signé par le préfet le 22 mars 1939. Ange et Baptistine obtinrent la nationalité française le 13 juillet 1939 (annonce au JO le 23 juillet), un mois et demi avant le début de la Seconde guerre mondiale.
En 1940 ou 1941, leur maison fut perquisitionnée par la police à une période où celle-ci multipliait les descentes chez des militants politiques fichés avant la guerre. Était-ce en lien avec les activités connues de Paul (il avait adhéré à la CGT en 1937), avec celles d’Ange, à cause d’une dénonciation ? Difficile à déterminer avec certitude. Angelo Argiolas était fiché par la police italienne en tant qu’antifasciste domicilié en France. Les archives du Casellario Politico Centrale (Bureau central des archives politiques italiennes) possèdent un dossier le concernant sur la période 1938-1943 avec pour métier « contadino » (paysan), ce qu’il était lorsqu’il émigra en France en 1920. L’affaire Luigi Bastoni, du nom d’un antifasciste italien installé dans les Bouches-du-Rhône et persécuté par les autorités dans les années 1930, est un exemple de la vitalité de la collaboration entre police française et police fasciste pour traquer les antifascistes italiens en France.

Lorsque le dossier de naturalisation française du couple Argiolas passa devant la commission de révision des naturalisations – créée par Vichy le 22 juillet 1940 pour accomplir la « Révolution nationale » en excluant de la nation juifs, communistes, homosexuels, handicapés mentaux et autres « indésirables » – il ne suscita toutefois pas d’hostilité. Il fut traité à deux reprises : le 23 juin 1941 et le 21 août 1941, où fut décidé le maintien de la nationalité française pour le couple de natifs italiens. Il semble qu’il n’y avait donc pas de militant identifié comme tel dans la famille. Par contre, les Argiolas eurent des démêlés avec la justice pour leur manière de faire face aux privations. Baptistine fut condamnée en juin 1941 à payer une amende de 25 F pour avoir acheté une feuille de tickets de pain. Le 15 septembre 1942, Ange était cet homme d’1 m 63, aux « cheveux et sourcils grisonnants », au visage ovale et au teint mat qui apparaît dans les procès-verbaux de la brigade de gendarmerie de Port-de-Bouc. « Vétu d’un complet bleu de chauffe – coiffé d’une casquette grise – chaussé de souliers haut noirs », il avait été arrêté à 3h45 du matin dans le champ du voisin, M. Roques (ou Roque), 78 ans, avec Jean-Marie, qui avait volé environ 15 kg de raisin pour nourrir la famille. Deux gendarmes, Joseph Cros et Gilbert Roure, attendaient en embuscade sur le terrain. Le propriétaire s’était plaint de vols de fruits répétés. Ange déclara avoir demandé à son fils de jeter ce raisin avant l’arrivée des gendarmes. Le commissaire précisait le 17 septembre à l’attention du parquet du Procureur de la République d’Aix qu’Argiolas était de « tempérament très orgueilleux » mais n’avait jamais eu affaire à la police. Le 24 septembre, le tribunal d’Aix le condamna à deux mois de prison avec sursis pour complicité de vol de récoltes tandis que Jean-Marie écopait de deux mois de prison ferme.
Sur le plan politique, Paul Argiolas rejoindra le PCF dans la clandestinité en novembre 1943, Jean-Marie à la fin de la guerre en mai 1945. Pascaline et Élisabeth, plus jeunes, le feront plus tard. Selon les souvenirs d’Élisabeth, les fils Argiolas allaient s’isoler du regard des voisins et des autorités dans le poulailler de la famille. C’est là que Paul rédigea des papillons pour la Résistance tandis que Jean-Marie y aurait caché des explosifs. En 1943, l’un et l’autre étaient membres des FTP. La famille devait être d’autant plus vigilante que les propriétaires de la maison, qui vivaient dans le quartier, ne cachaient pas leurs sympathies fascistes et qu’il y eut à partir de 1943 un grand nombre d’Allemands aux alentours. Paul alla brièvement se cacher chez le cheminot communiste Marius Tassy. L’armée d’occupation avait installé des batteries de tir à proximité de la maison. Par conséquent les avions anglais et américains venaient régulièrement mitrailler le quartier. Ange avait creusé un abri dans le sol du jardin. Lorsque les coups de feu ou les sirènes les réveillaient la nuit, la famille allait s’y réfugier.

D’après sa fille, Ange Argiolas aurait travaillé à l’usine Kuhlmann jusqu’à ce que les Allemands ne fassent de lourds dégâts à l’explosif. Il s’avère que c’est à l’usine Verminck, à deux pas de la première, que les troupes d’occupation firent sauter les quais. Quoiqu’il en soit, les deux usines fermèrent au cours de l’année 1943. Argiolas travailla par la suite dans le même quartier, en tant que docker au port de Caronte, comme son fils Jean-Marie. Dans l’Après-guerre il fut embauché chez Verminck.
En février 1947, le Journal officiel annonçait la mise sous séquestre des "biens, droits et intérêts appartenant directement ou indirectement" à Ange Argiolas. L’adresse du 2 rue de l’Église à l’Estaque était visée par une ordonnance de décembre 1946 décrétant "ennemies" une liste de personnes aux noms étrangers (dont beaucoup d’Italiens et de Sardes). S'agirait-il des effets de la non-reconnaissance par l’administration française de la co-belligérance de l’Italie auprès des alliés après la chute de Mussolini ?

De juin à octobre 1949, Port-de-Bouc subit le lock-out des Chantiers et Ateliers de Provence, opposant les travailleurs du chantier naval à leur direction. Cette dernière voulait imposer une réduction du revenus des ouvriers d'environ 20 % (par la suppression d'une prime au lancement des bateaux) et casser l’influence du Syndicat CGT des Métaux. La famille Argiolas fut particulièrement touchée par ce conflit : Paul faisait partie des responsables syndicaux et Baptistine du comité des femmes présentes tous les jours aux côtés des grévistes.
La même année, Ange Argiolas apprit par une voisine indiscrète que Pierre Brocca, fils de voisins sardes, faisait la cour à sa fille Élisabeth à travers la fenêtre de la Poste où elle travaillait. Ange voulut bastonner le jeune homme, comme lui avait autrefois été attaqué par les frères Cesaraccio. Sportif, Brocca évita le projectile, un gourdin qui lui était destiné, et prit la fuite. Élisabeth Argiolas et Pierre Brocca se marièrent en août 1949. Le mois précédent, Catherine Brocca, la sœur de Pierre, avait épousé Paul Argiolas.

Ange Argiolas manifesta son attachement aux traditions sous des formes plus conviviales. Dans sa manière de recevoir par exemple. Quelle que soit l’heure de la journée, il accueillait ses visiteurs en leur offrant du fromage de brebis sarde, qu’il sortait d’une niche creusée dans le mur, et du vin rouge, comme on recevait en Sardaigne. Il inculqua à ses enfants l’importance de connaître la nature et ses fruits. Très attaché au Parti communiste, il se disputait souvent avec Paul, qui avait des vues différentes des siennes. "Son" journal, l’Humanité, était précieux à ses yeux. Dans les années 1960, il allait encore le vendre à vélo. Quand il fut à la retraite il consacra beaucoup de temps aux deux jardins qu’il avait, aux Comtes et au quartier Saint-Jean. Après le décès de sa femme, il retourna à Oniferi en 1983 pour y voir sa sœur Giovanna Maria. Il avait dans l’idée d’y rester. Mais la Sardaigne avait bien changé en soixante ans… Il dût s’y sentir étranger et rentra assez vite dans sa maison du quartier des Comtes à Port-de-Bouc.
On dit qu’il serait mort en lisant l’Humanité. Il repose au cimetière communal, dans une tombe adjacente à celle de sa femme Baptistine.
Sources : Arch. Nationales, dossier de naturalisation N° 22330 x 1938. — Arch. Dép. Bouches-du-Rhône, 1 W 3119 n°309. — Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, busta 185, estremi cronologici 1938-1943 (nc). — Livret de famille. — Archives Argiolas. — État signalétique (en italien). — Journal Officiel de la République. Lois et décrets, 23 juillet 1939 (71e année, N°172), p. 9363 ; 3 et 4 février 1947 (79e année, N°30), p. 1207. — Roland Joly, Antoine ou la passion d’une vie : Une histoire de Port-de-Bouc, ville mosaïque, auto-édition, 2005 (pp. 9-10). — Jo Ros, René et Élisabeth Brocca, Pierre Brocca partage sa vie et sa passion des boules, auto-édition, 2017. — Le Petit Provençal, 6 mai 1923, 28 novembre 1923. — Recherches généalogiques sur les familles du village d’Oniferi. — Propos recueillis auprès d’Élisabeth Brocca, sa fille, et de Brigitte Argiolas, sa petite-fille. — Témoignage de Giampiero Casula.
1ere version dans Le Maitron : 13 mars 2022.
2e version : 1er mai 2024.
3e version : 5 septembre 2025.






Commentaires